![Darius le grand ne va pas bien [roman YA]](https://mapetitemediatheque.fr/wp-content/uploads/2021/10/Capture-decran-2021-10-20-175755.jpg)
Darius le grand ne va pas bien [roman YA]
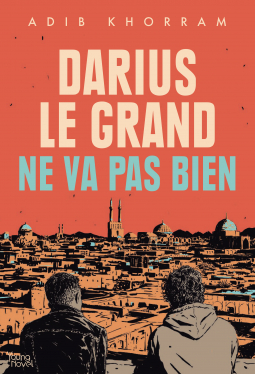
roman young adult de Adib Khorram publié chez Akata (2021), traduit de l’anglais américain par Thaïs Cesto, version originale publiée en 2018
Commençons par la fin : j’ai adoré ce roman. Maintenant le plus difficile, argumenter. J’ai réécrit cette chronique des dizaines de fois dans ma tête avant de me lancer. J’ai adoré ce roman et si je peux vous parler de tout un tas de raisons objectives qui font que je trouve que c’est un bon roman, si je l’aime d’amour c’est pour des raisons profondément et intimement subjectives.
En refermant ce roman, je me suis dit voilà un roman que j’aurais aimé lire à 15 ans. Je me serais sentie moins seule, enfin, peut-être. Mais avant de vous dire pourquoi j’ai été touché par ce récit, quelques mots sur l’histoire.
Darius est un jeune américain dépressif et mal intégré. Lycéen solitaire et victime de harcèlement, amoureux de thé et à l’héritage multiculturel. Son père est américain d’origine allemande tandis que sa mère est iranienne. Son quotidien morose va être bouleversé par un voyage en Iran. Il n’a jamais mis les pieds dans ce pays et sa famille iranienne il ne la connaît qu’à travers le filtre d’un écran. En apprenant que le grand-père est gravement malade, la famille décide de partir en Iran quelques semaines. L’occasion pour Darius de rencontrer cette branche de la famille, jusque là virtuelle, de découvrir le pays de sa mère, de mieux connaitre ses origines et aussi de se faire un ami, son véritable premier ami. Un jeune homme du quartier des grands-parents qui lui aussi doit subir le poids d’une différence et qui sait ce que c’est de se sentir mis à l’écart. Un jeune homme au grand coeur avec qui Darius n’a pas besoin de faire semblant. Une rencontre qui va changer la vie de Darius, un peu. Et c’est déjà beaucoup.

Relief de Darius Ier à Persépolis
J’ai aimé le style de Adib Khorram. Même s’il nous parle de dépression, le style et léger et drôle, bourré de référence à la culture geek, très vivant. Le récit est à la première personne, c’est Darius lui-même qu’i nous raconte son histoire, et il interpelle le lecteur en le prenant à témoin, mais en réalité, plus qu’un dialogue avec le lecteur, cela m’a paru être un dialogue intérieur, Darius se parle à lui-même comme s’il s’adressait à quelqu’un d’autre. Moi j’aime beaucoup parce que je fais ça tout le temps. Et ce n’est pas le seul point commun que je partage avec Darius. Même si nous avons une histoire différente, que nous ne venons pas du même pays et nous ne faisons pas face aux mêmes problèmes je me suis reconnu dans Darius. Je partage avec lui une façon d’être, un malaise aussi, un décalage. Comme Darius j’étais une étrangère où que je me trouvasse, comme lui je me sentais en décalage et rejetée par les jeunes de mon âge, je ne trouvais pas ma place ni à l’école, ni à la maison, et je me prenais beaucoup la tête en surinterprétant tout.
Et ce que j’ai aimé trouver ici, c’est la bienveillance. Abid Khorram aborde le thème de la dépression, qu’il connaît bien pour l’avoir lui-même vécu, avec beaucoup de bienveillance, sans pour autant dédramatiser. Les symptômes émotionnels de Darius sont bien réels, tout comme son traitement médical. À aucun moment on ne cherche à minimiser, mais il se dégage de cette lecture quelque chose de chaleureux et positif. Tout au long de ma lecture j’ai éprouvé beaucoup d’empathie pour Darius, et par ricochet beaucoup d’empathie pour l’ado que j’avais été.
À chaque fois que Darius nous parle de ses sauts d’humeur, de son ressenti, il conclut toujours par un « c’est normal. Pas vrai ? ». Et dans mon for intérieur je lui disais : « mais oui ! c’est normal… pas vrai ? ». Darius a besoin d’être rassuré. Et ce besoin m’était très familier. J’ai senti l’enfant qui est en moi s’émouvoir et me demander la même chose.
Je bus mon thé, respirai l’odeur du jasmin et me demandai si quelqu’un serait triste si je mourrais dans un accident de voiture, ou autrement. Ce qui était normal. Pas vrai ?
Cette lecture est venue me mettre du baume au cœur parce qu’il m’a fait me sentir normale. Finalement, dès le moment où l’on n’est pas seul, on devient un peu plus normaux. C’est pour ça que je disais en introduction que c’est un roman que j’aurais aimé lire à 15 ans. Cela m’aurait peut-être aidée à me sentir moins seule et plus normale. Je ne vais pas m’étaler davantage sur le sujet. Rien que d’écrire ces quelques lignes, je suis toute remuée.
Je vais en revanche vous parler d’autres aspects que j’ai adoré dans ce roman. Déjà la culture geek à laquelle je faisais référence plus haut. Darius est un grand fan de Stat Treck ou encore du Seigneur des Anneaux, et il intègre le vocabulaire propre à ces univers dans sa vie de tous les jours, comparant les objets et les personnes rencontrées aux objets et personnages de fiction. Moi j’ai trouvé ça très drôle. En revanche celui qui ne connaît pas du tout ces univers risque de se sentir un peu perdu. Moi j’ai apprécié, ça donne un décalage à la situation, une distanciation aussi peut-être. Submergé par ses émotions, Darius prend de la distance en comparant la vraie vie à la fiction, de façon à la rendre plus supportable.

Star Trek : La Nouvelle Génération
Mais la vraie vie que l’on rencontre dans ce récit est aussi très intéressante. Darius a grandi dans la culture persane au sein d’une communauté d’expatriés, mais il n’a jamais mis les pieds en Iran. Nous découvrons le pays avec lui et avec lui nous nous émerveillons. Une très large place est laissée à la nourriture, et j’ai adoré découvrir les différents plats et parfums qu’on rencontre tout au long du voyage. Une véritable invitation à la découverte. En lisant ce livre on n’a qu’une envie, découvrir l’Iran et sa gastronomie. J’adore.
En résumé j’ai tout aimé dans ce roman, le personnage attachant auquel je me suis identifié, le style très moderne et vivant de l’écriture, les clins d’œil à la culture geek et le voyage riche en saveurs et en découvertes qu’il nous fait faire.
Que demander de plus ? La suite bien sûr ! Le roman vient tout juste de sortir aux éditions Akata, la version originale date de 2018 et une suite existe déjà en anglais (Darius the Grat Deserves Better), j’espère qu’elle sera également publiée en France.
→ sur le site des éditions Akata
→ sur Amazon ou chez votre libraire préféré
Ne partez pas encore ! Je vous ai préparé une petite liste d’extraits gourmands pour le challenge Des livres (et des écrans) en cuisine
(je ne vais pas tout vous mettre, j’ai surligné plus de 30 passages ! juste de quoi vous mettre en appétit)
–Darioush-jan, tu aimes les qottab ?
Les qottab étaient de petites pâtisseries fourrées aux amandes concassées, au sucre et à la cardamome, que l’on plongeait dans la friture puis que l’on recouvrait de sucre glace. C’étaient mes gâteaux préférés. D’après ma mère, Yazd était plus ou moins la capitale du dessert en Iran, et ce depuis des milliers d’années. Tous les meilleurs desserts venaient d’ici : les qottab, les noon-e panjereh (des beignets croustillants saupoudrés de sucre glace), et le lavashak (la version iranienne de la pâte de fruits, fabriquée à partir de fruits qui poussaient ici, comme la grenade ou le kiwi). Les Yazdis avaient même inventé la barbe à papa, qu’ils appelaient pashmak.

qottab
–Vous n’aimez probablement pas ce ragoût, Stephen, lança-t-il. La plupart des Américains n’aiment pas le fesenjoon.
–Je trouve ça délicieux, répondit mon père. C’est mon préféré. Shirin m’a appris à le préparer.
Ce qui était vrai, mon père en raffolait vraiment. Et le fesenjoon était un plat difficile à aimer au premier essai. Il ressemblait légèrement à de la boue. Bien pire que de la boue, on aurait dit une sorte de gelée produite par de nouveaux dérivés d’acides aminés qui se seraient assemblés en protéines pour créer de nouvelles formes de vie. Babou avait raison de dire que les non-Persans (et même ceux qui ne l’étaient qu’à moitié) se méfiaient du fesenjoon, ce qui était dommage, puisqu’il ne s’agissait que de poulet, de noix moulues et de mélasse. C’était un mélange parfait de saveurs sucrées, salées et aigres.
–Vous mangez comme un Américain, fit remarquer Babou. Il leva le menton en direction des mains de mon père, qui tenait un couteau et une fourchette. Babou –tout comme Mamou, Sohrab et ma mère –utilisait une fourchette et une cuillère, qui était la façon de manger de beaucoup de Persans.

fesenjan (j’ai piqué cette joli photo IranDestination, cliquez sur le lien pour accéder à la recette)
Lorsque nous préparions du chelo kebab à la maison, ma mère s’occupait du chelo – elle connaissait la recette secrète du tahdig parfait – tandis que mon père se chargeait de préparer le kebab. La maîtrise des viandes grillées était un élément essentiel à la constitution d’un Übermensch teuton digne de ce nom. Ma mère avait dû mentionner les compétences surnaturelles de mon père en matière de kebab , car Mamou le chargea d’enfiler le bœuf haché du kebab koobideh sur les brochettes. Mon père disposa la viande autour des larges brochettes en métal, les pinçant entre son index et son majeur et les faisant bouger de haut en bas le long de la lame pour bien les fixer, tandis que ma mère aida Mamou à couper la poitrine de poulet en dés, à l’aide d’un hachoir si grand qu’il sembla sortir tout droit d’un dessin animé.

Chelo Kebab et Koobideh (j’ai piqué cette photo sur 196 flavors, cliquez sur le lien pour accéder à la recette)
Petit clin d’œil aussi au challenge Contes & Légendes
Le prénom Sohrab tire son origine de l’histoire de Rostam et Sohrab dans le Shahnahmeh, qui n’est ni plus ni moins que le Silmarillion des contes et légendes persanes. Il comporte d’autres histoires, comme celle de Feridoun et de ses trois fils, et celle de Zal et du Simurgh (qui est la version persane du phénix) ou encore du roi Jamsheed, mais aucune d’elles n’est aussi connue que celle de Rostam et Sohrab. Rostam était un combattant légendaire qui tua accidentellement son propre fils, Sohrab, au cours d’une bataille. Cette histoire était profondément tragique.

Un Lamassu était en quelque sorte la version persane d’un sphinx : il s’agissait d’un animal hybride avec la tête d’un homme, le corps d’un bœuf et les ailes d’un aigle. Pour autant que je sache, il n’était pas question d’énigmes dans les rencontres mythologiques avec les Lamassu, mais j’étais prêt à parier qu’elles impliquaient un très haut degré de taarofage.



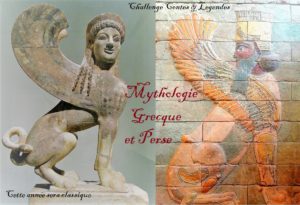
On sent à quel point ce roman t’a touchée… Je me le note, bon week-end!